Les sirènes d’alerte à Kyiv et les flammes au-dessus des immeubles détruits ne sont pas seulement l’image de la guerre. Elles sont le rappel brutal que l’Ukraine vit chaque jour sous la menace d’une puissance qui a choisi la force plutôt que le droit. Plus de trois ans après le déclenchement de l’invasion à grande échelle, les attaques russes ne cessent pas. Elles s’intensifient. Elles visent les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les lieux symboliques. Elles visent surtout à briser un peuple.
La stratégie d’usure
La Russie n’avance pas à pas de géant. Elle avance à coups de missiles. Sa stratégie n’est plus la conquête éclair — échec patent du début de la guerre — mais une guerre d’usure. Elle joue sur le temps, l’épuisement, la lassitude. Elle veut transformer l’Ukraine en champ de ruines et l’Occident en spectateur fatigué. Ce choix cynique, qui prend les civils pour cible, est une démonstration de faiblesse militaire autant qu’un pari sur l’endurance.
Les ambitions réelles de Vladimir Poutine
Poutine le répète à mots couverts : ce n’est pas seulement l’Ukraine qu’il combat, c’est une idée. L’idée qu’une nation née de l’ex-URSS puisse choisir son destin, son modèle politique, son ancrage européen. L’idée qu’une démocratie, même imparfaite, puisse prospérer à la frontière russe.
Reconnaissance de la Crimée, abandon du Donbass, neutralité forcée de l’Ukraine : ce sont les revendications visibles. Mais l’ambition profonde est plus vaste : reconstruire une sphère d’influence impériale et imposer une logique où la souveraineté des peuples devient négociable dès lors que le plus fort en décide autrement.
L’Occident à la croisée des chemins
Face à cela, la communauté internationale réagit, mais de manière inégale. L’Union européenne et les États-Unis fournissent argent, armes, sanctions. Mais souvent trop tard, trop peu, trop divisés. Chaque hésitation nourrit le calcul du Kremlin : plus la guerre dure, plus l’Occident se lasse, plus l’Ukraine s’épuise.
Le reste du monde, lui, regarde ailleurs. Certains pays s’abstiennent, d’autres négocient avec Moscou. La Russie survit économiquement grâce à ses alliances avec Pékin, Téhéran, ou encore certains acteurs du Sud global. Le système de sanctions est contourné, le commerce réorienté, l’autarcie organisée.
Pourquoi cette guerre nous concerne tous
Se dire que l’Ukraine se bat « pour elle-même » serait une illusion. Si Poutine l’emporte, il aura prouvé qu’un État peut effacer les frontières de son voisin par la force, sans conséquence insurmontable. Ce précédent pèsera sur l’Europe, mais aussi sur l’Asie, l’Afrique, partout où les rapports de puissance menacent les équilibres fragiles.
À l’inverse, si l’Ukraine résiste, ce ne sera pas seulement une victoire nationale. Ce sera la démonstration qu’un ordre international fondé sur des règles, aussi imparfait soit-il, peut encore l’emporter sur la loi de la jungle.
L’heure de vérité
Nous sommes arrivés à un moment décisif. Pour l’Ukraine, évidemment : chaque jour compte, chaque missile tue. Mais aussi pour nous. Car ce qui se joue sur les rives du Dniepr, c’est bien plus que la survie d’un pays. C’est la réponse à une question simple, mais implacable :
Voulons-nous vivre dans un monde où le plus fort dicte sa loi ? Ou défendons-nous encore l’idée que la souveraineté, la liberté et le droit ont une valeur universelle ?
L’Ukraine paie aujourd’hui le prix du sang. Mais le coût d’une indifférence ou d’un soutien tiède pourrait, demain, être infiniment plus élevé pour l’Europe et pour l’ordre mondial tout entier.

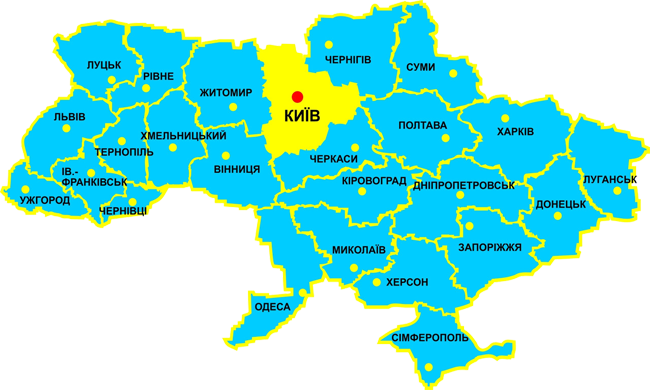












0 commentaires